Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir ? Qui n'a jamais rêvé d'avoir le "pouvoir" de trouver des réponses en interprétant les tarots ou l'astrologie ? Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus et qui veulent apprendre à tirer les cartes, sachez que c'est possible. Prêt à découvrir votre avenir?
Commencer la pratique du tarot
Pour tirer les cartes ; il vous faut un jeu de tarots. Les cartes de tarots se nomment arcanes ou lames, il existe 22 arcanes majeurs et de 56 arcanes mineurs. Il faut également se procurer un manuel qui vous apprendra la méthode à appliquer ainsi que les interprétations de chaque carte et de leurs combinaisons.
Concentration, calme et sérieux doivent être au rendez-vous si vous souhaitez obtenir de véritables résultats. Tout le monde peut apprendre à tirer les cartes. Pour cela il faut apprendre la signification des lames et commencer par poser des questions simples. Le contact avec votre jeu est important pour créer un lien entre vous et vos cartes. C'est avec la pratique que vous deviendrai de plus en plus à l'aise et que vos interprétations seront de plus en plus juste. Comme c'est le cas pour toutes les disciplines, la maîtrise du tarot viendra avec le temps, alors soyez patient...
Faut-il un don de voyance pour la pratique du tarot ?
Et pour répondre à cette question que chacun d'entre nous se pose avant de se lancer dans une telle discipline, direction Les lubies de ludi qui a consacré un bon article sur l'astrologie de l'âme, un blog bien fait qui nous répond qu' il n'est pas nécessaire d'avoir des dons de voyance pour pouvoir interpréter les lames du tarot . Il suffit de bien s'imprégner de la signification des cartes, ainsi que de leurs assemblages pour pouvoir répondre à des questions qui nous préoccupent. Lorsqu'on ne possède pas de don de voyance, il ne s'agit pas de se prendre pour Maud Kristen. Par contre, lors d'une préoccupation précise, on peut employer sans problème le tarot pour qu'il nous apporte une réponse."
Que peut-on demander aux cartes ?
Il existe quatre grands thèmes: vie sentimentale, vie professionnelle, avenir financier, santé. Les questions peuvent donc être vastes, mais si aucun domaine n'échappe à la cartomancie, il existe des limites.
Tout d'abord, évitez de poser des questions inutiles, le tirage des tarots n'est pas un jeu, c'est un moyen d'en savoir plus sur vous même et sur votre avenir. Ensuite soyez clair sur la formulation des questions, plus vous apprendrez à être précis, plus les résultats seront probants.
Enfin sachez que parfois les réponses aux questions posées ne sont pas plaisantes à entendre. Alors avant chaque tirage demandez vous si vous souhaitez réellement découvrir la réponse à votre question...
Apprendre à tirer les cartes
Pour apprendre le tarot et à interpréter les cartes, nous vous conseillons de découvrir : Le tarot des bohémiens du célèbre PAPUS ou Les tarots de Marseille, de Louise Beni et Catherine Bodin, , ouvrage qui a pour objectif de "donner des réponses aux questions les plus courantes à travers un tirage simple; faisant ainsi des tarots un outil accessible, clair, fiable et remarquablement facile à utiliser. De plus, il permet au lecteur d’être guidé pas à pas dans l’esprit de la cartomancie par une professionnelle confirmée."
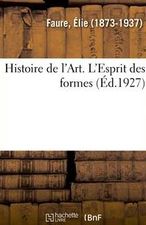
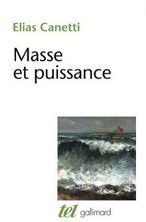


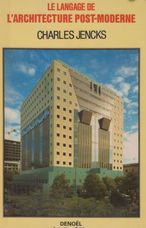


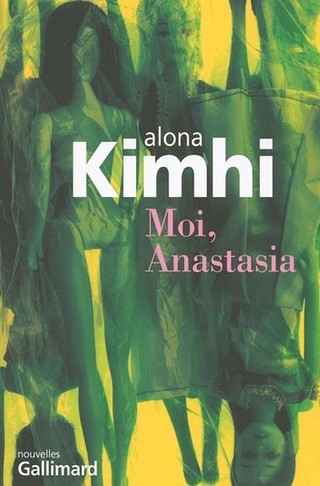 Moi, Anastasia par Alona KimhiIl y a peu de livres que je déteste, ou qui m’agacent – Il y a par contre un style d’écrivain qui me file des boutons, et c’est exactement le créneau d’Alona Kimhi, auteur israëlienne née en Ukraine. Un style qui plaît, pourtant, puisque le magazine “Lire” l’a sélectionnée parmi les 50 écrivains « pour demain » - Explication vaguement sibylline qui ne veut rien dire autant qu’elle fait du flan, tiens ! Ca me rappelle quelque chose… Oui, son livre, exactement.
Moi, Anastasia par Alona KimhiIl y a peu de livres que je déteste, ou qui m’agacent – Il y a par contre un style d’écrivain qui me file des boutons, et c’est exactement le créneau d’Alona Kimhi, auteur israëlienne née en Ukraine. Un style qui plaît, pourtant, puisque le magazine “Lire” l’a sélectionnée parmi les 50 écrivains « pour demain » - Explication vaguement sibylline qui ne veut rien dire autant qu’elle fait du flan, tiens ! Ca me rappelle quelque chose… Oui, son livre, exactement.